Histoire
On ne vous raconte pas toute l'Histoire ?
 L’enseignement primaire et secondaire et les documentaires historiques comme la série Apocalypse[1] donnent une image biaisée de l’Histoire. Cette dernière apparaît comme une succession de dates, de périodes clairement définies (Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine)[2], de régimes politiques (l’Empire romain suit la République romaine ; les Mérovingiens précèdent les Carolingiens ; la monarchie laisse place à la République première du nom suivie du Consulat puis de l’Empire napoléonien puis de la Restauration, puis de la Monarchie de Juillet puis de la IIème République puis du Second Empire puis de la IIIè République… on n’en finit plus), de batailles (qui a oublié la date de la bataille de Marignan ?). Mais l’Histoire, ce n’est pas que ça.
L’enseignement primaire et secondaire et les documentaires historiques comme la série Apocalypse[1] donnent une image biaisée de l’Histoire. Cette dernière apparaît comme une succession de dates, de périodes clairement définies (Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine)[2], de régimes politiques (l’Empire romain suit la République romaine ; les Mérovingiens précèdent les Carolingiens ; la monarchie laisse place à la République première du nom suivie du Consulat puis de l’Empire napoléonien puis de la Restauration, puis de la Monarchie de Juillet puis de la IIème République puis du Second Empire puis de la IIIè République… on n’en finit plus), de batailles (qui a oublié la date de la bataille de Marignan ?). Mais l’Histoire, ce n’est pas que ça.
D’une « histoire-bataille » à une « histoire totale » : aperçu historiographique
Au moment où l’histoire se constitue en science humaine institutionnalisée à l’université au XIXe siècle, l’histoire politique, militaire et diplomatique de type évènementiel domine la discipline avec l’Ecole méthodique de Langlois et Seignobos. L’Ecole méthodique se veut objective : l’historien est considéré comme celui qui extrait la vérité historique, les faits des documents écrits qui sont ses sources. A partir des années 1930, avec l’Ecole des Annales initiée par Marc Bloch et Lucien Febvre (première génération), poursuivie notamment par Fernand Braudel et Georges Duby (deuxième génération), le recours à des sciences sociales comme la sociologie permet l’émergence d’une histoire sociale, démographique et économique qui s’intéresse aux groupes sociaux et insiste davantage sur la longue durée que l’évènementiel. Cette dernière tendance s’accentue dans les années 1970 avec la « Nouvelle histoire » portée par la troisième génération de l’Ecole des Annales (Jacques Le Goff, Pierre Nora) qui s’intéresse à l’anthropologie et l’ethnologie pour faire une « histoire des mentalités », avant que ne s’impose l’histoire culturelle, laquelle est très en vogue aujourd’hui et est définie par Pascal Ory comme histoire « des représentations collectives propres à une société »[3]. Aujourd’hui, l’Histoire est une discipline plurielle. Au cours du XXème siècle, les historiens ont rejeté certaines conceptions de l’Ecole méthodique telles que le recours exclusif à l’écrit comme document et la conception positiviste du fait historique[4]. Ils ont cherché à élargir le champ de l’histoire à tous les aspects possibles, afin de parvenir à une « histoire totale » (idée plébiscitée dès la première génération de l’Ecole des Annales), conçue par Jacques Le Goff « aussi bien [comme] l’histoire matérielle que l’histoire morale des sociétés, l’histoire du biologique que l’histoire de l’imaginaire »[5].
Les enjeux de la prédominance d’une histoire politique dans l’enseignement
Ce résumé quelque peu grossier et caricatural de l’histoire de la discipline permet de voir que l’histoire est une science humaine et sociale riche qui ne se limite heureusement pas aux évènements politiques, diplomatiques et militaires. En classe préparatoire, j’ai appris que la géographie que l’on nous enseignait à l’école primaire, c’était la géographie des premiers temps, celle qui se pratiquait au moment où elle se constituait en discipline universitaire, une géographie physique se fondant sur l’étude des massifs montagneux, des cours d’eau, etc. En histoire, c’est un peu la même chose, on nous enseigne surtout ce qui était les premiers objets d’étude de la discipline. Mais quels sont les enjeux de l’enseignement de l’histoire et pourquoi l’histoire politique prédomine-t-elle? (Notons que le fait qu’elle prédomine ne peut en aucun cas être considéré comme quelque chose de naturel, d’évident ; cela vaut le coup de se demander ce que cela dit de notre société.)
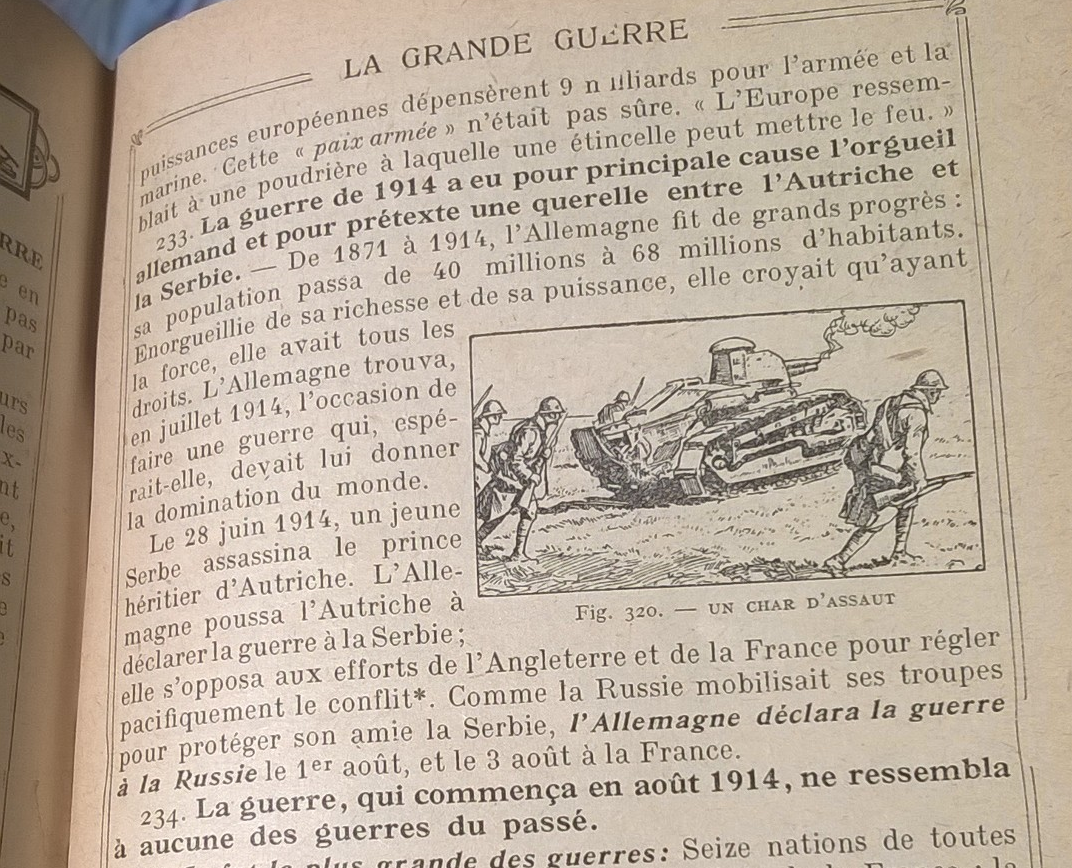 Ayant d’abord eu une finalité morale – l’histoire offre des exemples à rejeter ou à suivre - lors de ses balbutiements sous l’Ancien Régime, l’enseignement de l’histoire devient ensuite un enjeu éminemment politique[6]. Au XIXe siècle mais surtout sous la IIIème République (1870-1940), écrire et enseigner une « histoire-bataille » qui valorise les grandes figures héroïques et les grands règnes et qui célèbre la puissance de la France, c’est aussi une façon de consolider l’Etat-nation, l’adhésion de la population aux valeurs républicaines et son sentiment d’appartenance à la nation. L’Ecole est alors conçue comme une fabrique de citoyens patriotes prêts à défendre leur pays. Ce qui explique pourquoi l’histoire enseignée était patriotique, au point que dans un manuel d’école primaire de 1929, on peut lire « La guerre de 1914 a eu pour principale cause l’orgueil allemand. » Les années 1970 sont un moment de réformes de l’enseignement de l’histoire dont la finalité patriotique disparaît au profit d’une finalité davantage civique.
Ayant d’abord eu une finalité morale – l’histoire offre des exemples à rejeter ou à suivre - lors de ses balbutiements sous l’Ancien Régime, l’enseignement de l’histoire devient ensuite un enjeu éminemment politique[6]. Au XIXe siècle mais surtout sous la IIIème République (1870-1940), écrire et enseigner une « histoire-bataille » qui valorise les grandes figures héroïques et les grands règnes et qui célèbre la puissance de la France, c’est aussi une façon de consolider l’Etat-nation, l’adhésion de la population aux valeurs républicaines et son sentiment d’appartenance à la nation. L’Ecole est alors conçue comme une fabrique de citoyens patriotes prêts à défendre leur pays. Ce qui explique pourquoi l’histoire enseignée était patriotique, au point que dans un manuel d’école primaire de 1929, on peut lire « La guerre de 1914 a eu pour principale cause l’orgueil allemand. » Les années 1970 sont un moment de réformes de l’enseignement de l’histoire dont la finalité patriotique disparaît au profit d’une finalité davantage civique.
Aujourd’hui, l’enseignement de cette matière a pour but de permettre aux élèves de mieux comprendre le monde, d’éveiller leur esprit critique et de les sensibiliser à leur responsabilité de citoyen, selon l’inspection générale de l’Education nationale. L’étude de l’histoire militaire à l’école, et notamment de celle du XXème siècle, est davantage liée à un devoir de mémoire et insiste plus sur la violence de la guerre que sur les figures héroïques[7]. Mais, dans les esprits, l’enseignement de l’histoire reste primordial pour la construction identitaire des élèves (après tout, notre passé fait ce que nous sommes), ce qui explique les débats récurrents et les remodelages des programmes en fonction de demandes d’ordre mémoriel de la part de la société et du politique (par exemple, la nouvelle importance donnée à l’esclavage et à la traite négrière dans les programmes scolaires suite à une loi de 2001). Par conséquent, l’enseignement de cette matière est presque toujours celui d’une histoire très évènementielle, une histoire des dates des régimes politiques, des guerres, des événements diplomatiques et des relations internationales, saupoudrée d’une histoire économique, sociale, religieuse et intellectuelle de base. Cela a l’avantage de poser des cadres et des bases mais l’inconvénient de donner une image quelque peu rébarbative de la discipline et une vision tronquée de ce qui se fait véritablement dans la recherche. Certes, l’histoire a des enjeux politiques, d’ordre identitaire, civique et mémoriel, ce qui explique peut-être que son aspect politique prédomine à l’école. Mais son enseignement se doit aussi de prendre en compte l’avancement de la recherche.
 Nouveaux objets, nouveaux regards, nouvelles approches en Histoire : l’exemple de l’histoire des sensibilités
Nouveaux objets, nouveaux regards, nouvelles approches en Histoire : l’exemple de l’histoire des sensibilités
La recherche en Histoire cherche à prendre en compte tous les aspects de la vie passée, elle s’intéresse à de nombreux facteurs (techniques, économiques, politiques, religieux…) et de nombreuses catégories d’explication et d’interprétation (le genre, l’âge, la génération, le statut social…), elle s’écrit à partir de tout ce qui nous parvient du passé - pas seulement les documents écrits officiels, mais aussi les documents écrits personnels, les images, les objets, les enregistrements sonores et filmiques… La discipline est entrée dans un mouvement où de plus en plus d’objets deviennent légitimes à être étudiés dans une perspective historique : l’enfance, le sommeil, la sexualité, la télévision, les jeux vidéo, l’alimentation, la mort… Les objets d’étude plus traditionnels ne sont pas oubliés pour autant, mais ils peuvent faire l’objet de nouveaux regards, de nouvelles questions qui renouvellent leur approche. Pour tenter d’incarner mon propos, je prendrai l’exemple de l’histoire des sensibilités qui cherche à appréhender les sens, les perceptions, les émotions et les seuils de tolérance du passé, à « reconstituer la vie affective d’autrefois »[8]. Ce champ historique est d’ailleurs le thème du numéro de la revue L’Histoire de mars 2015 intitulé "Rire, Pleurer, Haïr au Moyen-Âge". Comment (res)sentait-on autrefois, comment exprimait-on ses émotions, quels étaient les valeurs et les usages sociaux des affects et des perceptions, comment la perception d’une chose (un objet, une pratique, un phénomène, un groupe humain…) évolue au cours du temps : ne sont-ce pas des questions aussi intéressantes que comment s’est déroulée la Révolution française ? Par exemple, dans Le Miasme et la Jonquille, Alain Corbin considère que l’odorat est une construction sociale, non une donnée universelle et immuable, et parle d’une « révolution olfactive » qui aurait eu lieu en France entre le milieu du XVIIIè siècle et la fin du XIXème siècle pour évoquer un abaissement du seuil de tolérance de la société aux mauvaises odeurs. Parmi les raisons de cet abaissement du seuil de tolérance, il évoque notamment l’association entre la puanteur et le miasme, le nauséabond et le malsain, qui entraîne des stratégies de désodorisation (de l’espace public mais aussi des odeurs corporelles trop fortes avec un progrès de l’hygiène corporelle de l’élite et son abandon des parfums insistants frappés peu à peu du signe du mauvais goût). Sans oublier l’association entre la puanteur et le pauvre dans un siècle de montée de la bourgeoisie qui veut se distinguer des masses laborieuses.
Depuis un siècle, on assiste à un progressif « élargissement du territoire de l’historien » (Philippe Poirrier), à quand des échos de cet élargissement dans l’enseignement et les documentaires historiques ?
[1] Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale (2009), Apocalypse, Hitler (2011), Apocalypse, la Première Guerre mondiale (2014), réalisés par Daniel Costelle et Isabelle Clarke, diffusés sur France 2.
[2] Rappelons que la périodisation est un découpage artificiel européo-centré (et souvent contesté) des historiens afin de structurer la discipline et la pensée ; il n’y a en aucun cas une rupture claire et nette entre deux périodes.
[3] L’Histoire culturelle, Pascal Ory, PUF, 2011.
[4] Les enjeux de l’histoire culturelle, Philippe Poirrier, Seuil, 2004.
[5] Objets et méthodes de l’histoire de la culture, Jacques Le Goff, Béla Köpeczi (dir.), éditions du CNRS, 1982.
[6] Voir L’enseignement de l’histoire en France de l’Ancien Régime à nos jours, Patrick Garcia et Jean Leduc, Paris, Armand Colin, 2003.
[7] Voir « L'histoire-bataille n'est plus un socle identitaire », Sébastien Ledoux, Le Monde, octobre 2013.
[8] Pour reprendre les termes de l’article de Lucien Febvre paru en 1942 « Comment reconstituer la vie affective d'autrefois ? La sensibilité et l'histoire ». Son appel reste lettre morte à l’époque.
Par Camille C.
